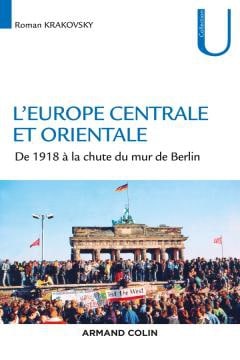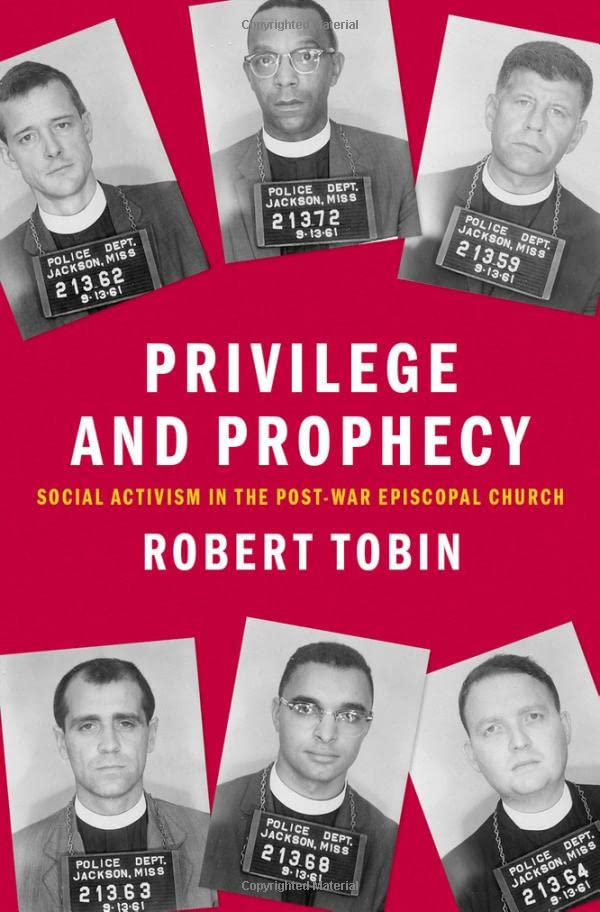Par Paul Bühle
Dix ans de préparation, cette histoire détaille l’évolution remarquable d’une « Église de l’établissement » au cours de près de trois générations. De nombreux volumes d’histoire peuvent prétendre à juste titre être complets, beaucoup également être bien écrits, mais relativement peu sont vraiment réfléchis. Privilège et prophétie : l’activisme social dans l’Église épiscopale d’après-guerrede Robert Tobin, un prêtre né aux États-Unis dans l’Église d’Angleterre, diplômé du Trinity College de Dublin, d’Oxford et de Cambridge, atteint toutes les notes élevées.
Comme l’explique l’auteur, d’autres dénominations se sont considérées comme «établies» pour diverses raisons, mais seuls les épiscopaliens peuvent revendiquer une lignée à l’Église d’Angleterre. Peu importe qu’ils se soient séparés officiellement et inévitablement en 1789. Pourtant, l’héritage persiste et façonne l’histoire à suivre.
La riche histoire des épiscopaliens du XIXe siècle à la guerre froide dépasse le cadre de ce volume, mais fournit néanmoins une toile de fond utile. Au cours de l’âge d’or, l’Église de l’establishment, prédominante dans toutes les strates de la richesse, du pouvoir et de l’influence américains, semblait poussée à s’adapter aux conditions changeantes plutôt que de devenir de moins en moins pertinente. Ou plutôt, des sections de l’église se sont adaptées, souvent en opposition à la direction plus conservatrice de leur dénomination. La pauvreté écrasante, les défis imposés par la montée des syndicats et les troubles sociaux généraux des dernières décennies du XIXe siècle ont provoqué la montée de l’Évangile social pour le protestantisme en général et, peut-être étonnamment, pour les épiscopaliens en particulier. Des socialistes chrétiens, des réformateurs du travail et des anti-impérialistes, noirs et blancs, pourraient être trouvés dans chaque mouvement progressiste ou réformateur dans la plupart des dénominations à suivre.
La majorité épiscopalienne conservatrice régnante a souvent tenu bon contre ces réformateurs. Pourtant, le statut des réformateurs au sein de l’Église les positionnait, individuellement et institutionnellement, pour exercer une influence considérable, et pas seulement au sein de l’Église. Franklin D. Roosevelt, lui-même de lignée quasi-aristocratique américaine, a déployé son privilège pour diriger de grands changements sociaux et pour effectuer la touche commune qui pouvait atteindre diverses populations avec quelque chose de plus que noblesse oblige.
Le succès inégalé de FDR, cependant, n’a pas résolu les contradictions fondamentales qui sont au cœur de l’analyse aiguë de Tobin. Lors des conventions générales des années 1930, des résolutions progressistes sur un large éventail de sujets, du travail à la protection sociale, ont été adoptées facilement, presque sans dissidence, mais aussi sans grand impact sur les congrégations. La Seconde Guerre mondiale et la consolidation du sentiment antifasciste ont suscité un vaste rapport de convention, Un monde meilleur pour tous les peuples (1943), qui présentait une vision d’une transformation mondiale d’après-guerre. Les hommes et les femmes d’Église, directement et indirectement impliqués dans les luttes militaires contre le fascisme, ont insisté sur le fait que le christianisme dans son ensemble était désormais confronté à une épreuve majeure. Paul Moore, Jr., William Wendt, Frank Sayre, Joseph Fletcher et G. Paul Musselman, entre autres, ont cherché à trouver la voie à suivre, mais se sont heurtés à une opposition considérable de l’église.
Une partie du problème, explique Tobin, découle d’une augmentation remarquable, bien que temporaire, de l’adhésion épiscopale, laissant les responsables de l’église lutter pour fournir un clergé frais et s’efforçant également d’un renouveau doctrinal adapté aux temps nouveaux. Il était trop facile, selon des critiques comme le laïc de plus en plus en vue William Stringfellow, de confondre la prospérité et le pouvoir de l’establishment épiscopal avec la réalité de la société qui l’entoure. Le clergé pro-travailliste et antiraciste a parfois indigné les responsables religieux de haut niveau et leurs congrégations prospères, en particulier dans le Sud. Le racisme auquel étaient confrontés les épiscopaliens noirs à tous les niveaux soulignait également l’urgence de la réforme et constituait également une lacune majeure de plus en plus marquée. Le sort du séminariste Jonathan Daniels, assassiné à Selma, Alabama, en 1965 alors qu’il protégeait un militant noir des droits civiques, a ajouté du poids aux accusations.
Comme l’explique Tobin, les épiscopaliens réformateurs considéraient l’élection de John F. Kennedy en 1960 comme une aubaine proverbiale. Paul Moore, évêque suffragant de Washington, DC, et intimement proche des sièges du pouvoir libéral, a proposé de façon dramatique qu’une autre réforme radicale soit à portée de main. Pendant ce temps, et lamentablement, l’avancée du mouvement des droits civiques, en particulier dans le Sud, a creusé le fossé entre les réformateurs et les non-réformateurs, c’est-à-dire les riches, les blancs et les aisés. Les conservateurs blâmeront plus tard les militants pour la baisse du nombre de membres de l’église, alors que les statistiques épiscopales ne faisaient que refléter celles des autres grandes dénominations. Bien plus tard, les accusations portées contre feu Paul Moore pour abus sexuels sur des séminaristes ont été considérées par certains comme invalidant son militantisme.
Au centre de l’analyse de Tobin se trouve l’impact de l’activisme sur la théologie au point de redéfinir le sens de l’épiscopalisme : le Mouvement est devenu le Message. La lutte pour les droits civiques serait naturellement considérée, et pas seulement dans les congrégations du Sud, comme un test de sincérité chrétienne. Rejoindre une ligne de piquetage ou un sit-in était devenu aussi bon, pour de nombreux jeunes épiscopaliens, que d’assister à des services religieux, voire mieux. Tobin offre une phrase merveilleuse à propos de la jeune génération : « ils voyaient l’église de leur enfance comme faisant partie du problème, plutôt que comme la solution à ce qui n’allait pas dans le monde ». (p.180). Le grand rôle public de l’évêque James Pike, star des médias des années 1950 jusqu’à sa mort, leader du mouvement social et prétendu hérétique au sein de l’église, a dramatisé la portée d’une personnalité de premier plan et ses complications, en particulier pour les membres plus âgés, théologiquement orthodoxes et politiquement conservateurs.
Les efforts pour créer et introduire de nouvelles liturgies s’avéreraient inévitablement traumatisants même pour les prêtres les mieux intentionnés : leur façon de penser, profondément liée à leur façon de parler, serait déséquilibrée et exigerait une adaptation majeure. La profondeur de la lutte au sein de la hiérarchie de l’église, selon Tobin, pourrait être incarnée par les problèmes soulevés par les revendications des femmes pour l’égalité dans l’église, puis pour l’ordination des femmes. L’apparition dramatique de Pauli Murray, qui attribuait les attitudes de l’Église à « l’aveuglement, le manque d’imagination et le manque d’expérience » de la part des dirigeants masculins (p.195), a enfoncé le clou dès les années 1960. Les engagements antiracistes plus tôt et l’inclusion gay plus tard s’avéreraient moins difficiles, moins clivants, mais seulement par contraste.
Tobin termine son récit avant le début du XXIe siècle. Il insiste néanmoins sur l’importance de la tension persistante. Dans son dernier sermon, en 1989, Moore, alors évêque du diocèse de New York, a exhorté sa congrégation à « libérer votre pensée de la métaphysique du passé vers une nouvelle dynamique de l’Évangile ». (p. 251) Aussi rédempteur que puisse paraître cet impératif, un sondage a révélé qu’en 1980, 69 % des épiscopaliens avaient voté pour Ronald Reagan et 60 % quatre ans plus tard. Voici le nœud du problème. Vers la fin du texte, Tobin confronte la réalité que la « réputation d’être une élite » (p.250) persiste pour les raisons les plus évidentes : même si leur nombre diminue, les épiscopaliens, en tant que groupe, comprennent de nombreux membres de la croûte supérieure. . Même les meilleurs efforts pour élargir l’église et en attirer d’autres peuvent sembler au mieux aux membres de l’église une présomption, suscitant des ressentiments et une sorte de «cohérence institutionnelle» (p.250) qui signale une stase malheureuse. Et pourtant la vie de l’église continue. Le un pour cent du public américain qui s’identifie maintenant comme épiscopalien a un poids très considérable dans la vie privée et publique, et le rôle des progressistes dans l’église reste très important.
Paul Buhle a parfois contribué à Le témoin, exutoire littéraire de longue date des progressistes épiscopaliens. Sa sœur est un membre actif d’une congrégation progressiste d’Evanston, dans l’Illinois.
Crédit image : Amazon
A lire:
,Le livre .